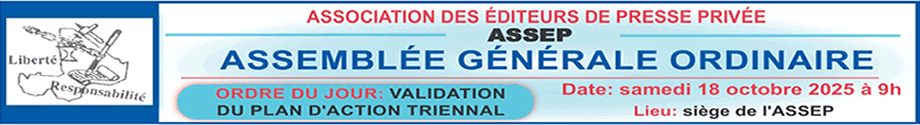Asphyxier la capitale, provoquer la colère, briser la cohésion nationale : la nouvelle stratégie des groupes armés vise à transformer la crise du carburant en arme politique. Face à ce danger, l’État malien déploie des moyens coûteux pour maintenir le pays debout.
Depuis plusieurs semaines, Bamako suffoque. Aux abords des stations-service, les files s’allongent, les moteurs s’éteignent, les rumeurs s’enflamment. En apparence, la capitale malienne vit une énième pénurie de carburant. En réalité, c’est une guerre silencieuse qui s’y joue — une guerre d’asphyxie savamment orchestrée par les groupes armés qui cherchent, par la pénurie, à affaiblir l’État et à fissurer la cohésion nationale.
Le carburant, nouvelle arme de déstabilisation
Les attaques contre les camions-citernes sur les routes du Sénégal et de la Côte d’Ivoire ne relèvent pas du hasard. Elles s’inscrivent dans une stratégie réfléchie : couper les artères économiques qui alimentent la capitale. En brûlant les citernes, en harcelant les transporteurs, les jihadistes visent à isoler Bamako, à faire naître la colère dans les foyers et à pousser les populations à se retourner contre les autorités.
Le calcul est limpide : si les habitants de la capitale manquent de carburant, si les prix flambent et si les frustrations explosent, alors le pouvoir en place perdra le soutien populaire. Et dans le même temps, les forces de défense et de sécurité, sous pression, seront contraintes de se recentrer sur la protection du sud, abandonnant progressivement les positions avancées dans le nord et le centre. C’est le piège qu’espèrent tendre les stratèges jihadistes : provoquer une rétractation du front sécuritaire et une implosion interne.
Une riposte coûteuse mais nécessaire
Conscientes du risque d’asphyxie, les autorités ont décidé de contre-attaquer sur le terrain logistique. Des moyens militaires et aériens ont été mobilisés pour sécuriser les routes d’approvisionnement depuis les ports de Dakar et d’Abidjan. Des convois de camions-citernes, parfois escortés par des blindés, traversent désormais le pays sous haute protection.
Cette opération, lourde et coûteuse, a un double objectif : garantir la continuité du ravitaillement et envoyer un signal fort — celui d’un État qui refuse de céder à la stratégie de l’étranglement. Selon une source sécuritaire, « chaque litre de carburant acheminé vers Bamako est une victoire contre la peur et la manipulation ».
Mais la manœuvre a un prix. La mobilisation de troupes, le carburant consommé par les escortes, les heures de vol d’aéronefs… tout cela pèse sur un budget national déjà éprouvé. Le gouvernement a fait le choix de l’effort, convaincu que céder sur ce terrain reviendrait à offrir à l’ennemi sa victoire la plus symbolique : celle du doute.
La guerre psychologique derrière la pénurie
Derrière les attaques matérielles se cache une guerre psychologique. Les groupes armés savent que dans une capitale exaspérée, les rumeurs valent parfois plus qu’une bombe. Chaque hausse de prix, chaque station à sec devient le prétexte à des spéculations : « le gouvernement cache les stocks », « les transporteurs ont arrêté », « le carburant est réservé aux militaires ». Autant de récits qui sapent la confiance, alimentent la défiance et divisent le peuple.
Or, c’est bien cette crise de confiance que cherchent à installer les jihadistes. Depuis douze ans, leur but n’a pas changé : épuiser le Mali, le pousser à s’effriter de l’intérieur, faire vaciller l’État non pas seulement par les armes, mais par l’usure, la peur et la désunion.
L’appel à l’unité et à la lucidité
Dans ce contexte, l’arme la plus précieuse du Mali n’est pas militaire : c’est la cohésion. Les autorités le répètent, les leaders religieux le rappellent, et la société civile le comprend peu à peu — seule l’unité peut neutraliser la stratégie de fragmentation.
Cela passe par la vigilance face aux spéculations, par le refus de céder à la panique, et par une responsabilité partagée dans la diffusion de l’information. Les médias, les transporteurs, les commerçants et les citoyens ont tous un rôle à jouer. Propager la rumeur, revendre le litre à prix d’or, c’est — qu’on le veuille ou non — contribuer à la stratégie ennemie.
Un pays sous test de résilience
Douze ans après le début du conflit, le Mali fait face à une nouvelle forme d’épreuve : non plus celle des armes seules, mais celle de la résilience collective. Le pari des groupes armés est clair : créer une crise économique et psychologique qui mine la solidarité nationale.
Le pari des autorités, inversement, est de prouver que l’État peut protéger — jusque dans les réservoirs des citoyens.
Entre ces deux logiques s’écrit aujourd’hui l’avenir du pays. La bataille du carburant n’est pas une simple crise d’approvisionnement : c’est un test de résistance nationale. Et dans cette guerre sans front visible, la première victoire est de ne pas céder à la peur.
Correspondance particulière