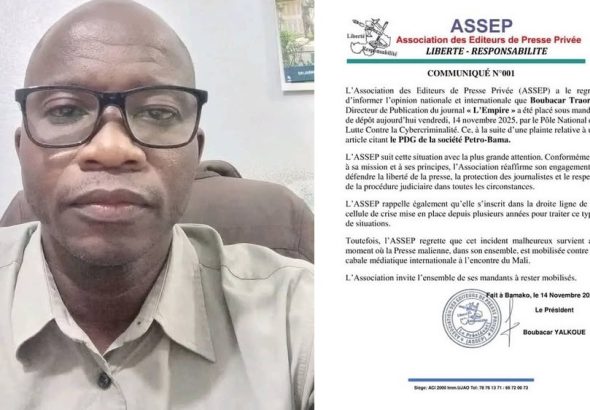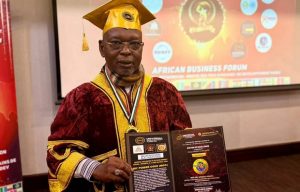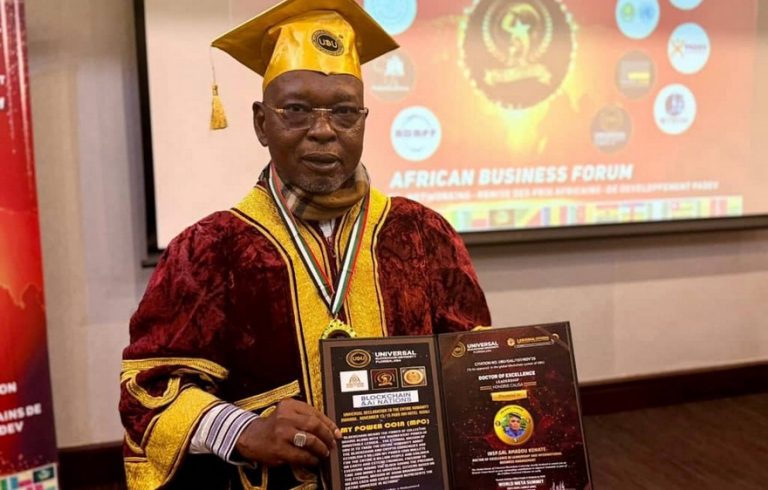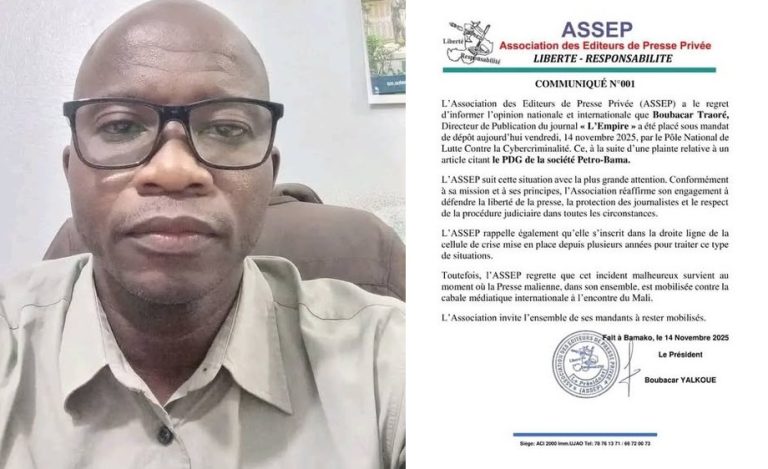Alors que le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau a échangé hier avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, pour saluer les efforts de l’armée malienne dans la lutte contre le terrorisme, cet appel marque un tournant diplomatique significatif. Il intervient quelques jours seulement après une alerte sécuritaire appelant les ressortissants américains à quitter le Mali, une mesure qui avait été suivie par onze autres pays occidentaux. Ce contraste apparent ne traduit pas une rupture, mais plutôt une tentative américaine de réajuster son approche dans un contexte géopolitique en pleine mutation.
Cette volonté américaine de maintenir la coopération avec le Mali, reflète bien les bonnes dispositions diplomatiques américaines de souscrire aux conditions maliennes nécessaires à une relation sincère et respectueuse de la souveraineté nationale.
Sur la plateforme X et le site officiel de l’ambassade des États-Unis au Mali, les autorités américaines ont exprimé leur reconnaissance envers les Forces armées maliennes (FAMa) pour leurs avancées contre le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM). Ce geste, loin d’être isolé, s’inscrit dans une volonté affirmée de maintenir ouverte la fenêtre de dialogue avec Bamako. L’appel téléphonique de Landau à Diop n’est que le premier jalon d’un couloir diplomatique que Washington semble vouloir emprunter avec constance, dans ce que certains observateurs qualifient déjà de “vrai-faux-départ”.
Ce repositionnement américain, bien que prudent, révèle une sincérité dans les doutes et hésitations légitimes face au nouveau positionnement du Mali dans l’ère multipolaire. Le gouvernement de Transition, en consolidant son alliance au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES) et en diversifiant ses partenariats stratégiques, notamment avec la Russie, Turkiya, la Chine, l’Iran, etc., affirme sa souveraineté et son droit à choisir librement ses alliés. Pour que la coopération avec 9 les États-Unis soit durable et crédible, elle doit s’inscrire dans le respect de cette souveraineté, sans inférence dans les choix politiques et économiques du Mali.
La crise énergétique actuelle, aggravée par les attaques du JNIM sur les convois de carburant, a mis en lumière la réactivité de partenaires comme la Russie, qui s’est engagée à livrer jusqu’à 200 000 tonnes de produits pétroliers par mois pour soutenir la résilience économique malienne. Ce soutien concret contraste avec les hésitations occidentales, et pousse les États-Unis à reconsidérer leur posture, non pas en renonçant à leur présence, mais en adaptant leur stratégie à une réalité nouvelle.
Dans cette recomposition géopolitique du Sahel, où l’OTAN redessine ses alliances et où des influences extérieures cherchent à s’imposer, le Mali ne se contente plus d’être un terrain d’intervention. Il devient un acteur stratégique, conscient de ses intérêts vitaux et de son rôle dans la stabilité régionale. Les États-Unis, en maintenant le dialogue, montrent qu’ils ne renoncent pas au Mali. Mais pour que cette coopération soit fructueuse, elle devra s’aligner sur les aspirations profondes des peuples sahéliens, et reconnaître que l’ordre mondial unipolaire cède progressivement la place à une ère multipolaire plus équilibrée.
Le Mali avance, et ceux qui veulent coopérer avec lui doivent le faire dans la vérité, le respect et la réciprocité. Le temps des injonctions est révolu. Le temps du partenariat sincère commence.
L’Aube / Rédaction